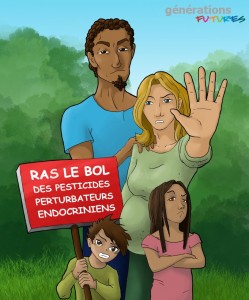Après l’alimentation il y a quelques jours, l’Anses vient de rendre ce 4 octobre un rapport portant sur 5 substances chimiques présentes dans les jouets et équipements en plastique des moins de 3 ans. L’exposition à de multiples substances chimiques présentes dans des produits de consommation, pendant les périodes critiques du développement de l’enfant (période périnatale, petite enfance), est évoquée parmi les hypothèses qui permettraient d’expliquer l’augmentation de l’incidence de certaines pathologies telles que l’obésité, les troubles neuro-développementaux, des effets sur l’appareil reproducteur, etc. Les enfants, en particulier ceux âgés de moins de 36 mois, constituent une population particulièrement vulnérable.L’Agence se veut rassurante, mais il faut rester prudent, car pour plusieurs des substances examinées, les données semblent insuffisantes. Notre partenaire le WECF vous livre ses conclusions principales.
Pourquoi les plastiques?
Il est rappelé que les jouets en plastique sont la catégorie de jouets la plus vendue en France, et que le plastique est, avant les tissus, le matériau le plus couramment mis à la bouche par les 0-3 ans. Le polychlorure de vinyle (PVC) représente l’une des matières plastiques les plus utilisées dans le domaine des jouets et les plastifiants les plus utilisés dans le PVC sont les phtalates.Le rapport rappelle par exemple les différents types de plastique utilisés pour les produits pour enfants : polyéthylène, polyesters (PES), polychlorure de vinyle (PVC), polypropylène (PP), polyuréthane (PU), polycarbonate (PC), poly acrylonitrile butadiène styrène (ABS), polyacétate de vinyle (EVA) et enfin époxydes (EP). Le marché du jouet progresse de 3 à 6% par an en Europe, malgré une baisse dans les pays du Sud. L’Anses s’est focalisée sur les jouets premier âge, les poupées et jeux de construction, les plus populaires. Sont notamment utilisés dans les jouets en plastique, des phtalates et substituts, des retardateurs de flamme (par ex., PeBDE, OBDE, DeBDE, TBBPA, HBCDE, TECP), des paraffines chlorées à chaînes courtes (SCCP), des HAP, du BPA et des métaux.
 Cadre de l’étude :
Cadre de l’étude :
- comprendre et réduire les expositions des plus jeunes aux substances les plus dangereuses (PNSE 2)
- jouets en plastique sont la catégorie de jouets les plus vendus en France
- Les 5 substances sur lesquelles l’expertise de l’Anses s’est concentrée sont les substituts de phtalates suivants :ATBC, DINCH, DEHTP, TXIB, DOIP
- le cyclohexane-1,2-dicarboxylate de diisononyle (DINCH),
- le téréphtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHTP),
- le di-2-éthylehexyle isophtalate (DOIP),
- l’acétylcitrate de tributyle (ATBC),
- le diisobutyrate de 2,2,4-triméthyl-1,3-pentanediol (TXIB).
Résultats & conclusions principales :
- 2 phtalates interdits retrouvés dans 4 jouets
- Pour 4 composés (ATBC, DINCH, DEHTP, TXIB), au vu des connaissances actuellement disponibles, il n’y a pas de mise en évidence de risques sanitaires pour les enfants de moins de 3 ans ;
- Pour le DOIP, le manque de données disponibles est problématique, et l’Agence recommande de ne pas l’utiliser dans les jouets et équipements en matière plastique, sans avoir au préalable acquis des connaissances sur sa toxicité ;
- Mener des tests de résistance à la salive de manière systématique pour tous les jouets destinés aux 0-3 ans ;
- Permettre un accès à des informations sur les rappels de produits (RAPEX) sur un site institutionnel en français
- Par ailleurs, au vu de la présence constatée de substances dont l’usage est restreint ou interdit dans de nombreux jouets commercialisés en Europe, l’Agence rappelle l’utilité des contrôles réalisés au niveau de la filière du jouet, afin d’éviter la présence sur le marché français de jouets non conformes à la réglementation, et recommande de maintenir a minima une telle pression de vigilance.
Retrouvez l’article dans le dossier ci dessous :
Consultez l’AVIS et RAPPORT de l’Anses relatif aux « Jouets et équipements pour enfants en matière plastique destinés aux enfants de moins de 3 ans »