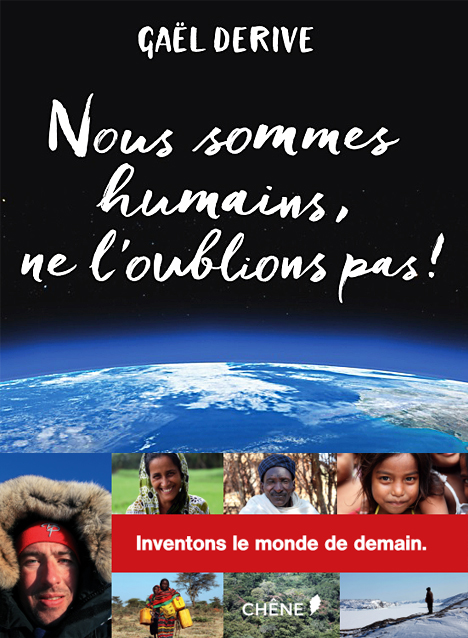L’Agence française pour la biodiversité (AFB) pilier de la loi sur la biodiversité, est présentée par le gouvernement comme le pendant de ce qu’est l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (l’ADEME) elle-même issue de la fusion de trois agences en 1991 – dans les secteurs des déchets et de l’énergie.
Cela fait près de quarante ans que le Parlement ne s’est pas penché sur le sujet : la dernière loi sur la protection de la nature – on ne parlait pas encore de biodiversité – remonte à 1976. Depuis, les objectifs et les outils de gestion se sont renforcés. Notamment sous l’effet de la directive cadre sur l’eau (DCE) de 2000 (objectif de bon état écologique des masses d’eau à atteindre en 2015 ou 2021 ou 2027), de la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM) visant le bon état écologique pour 2020) et des lois « Grenelle » de 2009 et 2010 (instaurant les trames vertes et bleues et les schémas régionaux de cohérence écologique : l’AFB en est le prolongement français.

L’AFB sera en effet un centre de ressources et un pourvoyeur d’appui méthodologique et de soutiens financiers aux acteurs de la biodiversité. « Tout le monde est convaincu de la nécessité de l’outil AFB, fondé sur la même logique que l’Ademe : il y a besoin d’une agence identifiée, qui porte la thématique et accompagne les acteurs », approuve l’élue régionale Annabelle Jaeger.
Comme l’Ademe, l’AFB pourrait ainsi financer des appels à projets et développer des référentiels pour que les collectivités et les entreprises dressent leur ‘bilan biodiversité’, tout comme elles établissent des ‘bilans carbone’. Elle appuierait le déploiement de stratégies de reconquête de la biodiversité, comme le fait l’Ademe sur les plans climat.
Ses missions premières :
- organiser la connaissance en matière de biodiversité
- sensibiliser les Français
- participer à la formation et à l’information des acteurs
- de soutenir financièrement des projets de restauration des milieux
- exercer des pouvoirs de police environnementale
Mais, contrairement à l’Ademe, le siège de l’AFB ne se prolongera pas d’antennes en régions. A ce stade du débat parlementaire, ses ressources ne le permettraient pas.
Surtout, les collectivités locales, premiers financeurs de la biodiversité, admettraient mal qu’un établissement public fasse seul autorité en la matière. « Dès lors, les collectivités n’imaginent pas travailler avec une Agence qui leur dirait ce qu’il convient de faire, en fonction d‘un cadre établi par l’Etat », commente Annabelle Jaeger. Au plan administratif, les communes ont besoin d’appui pour créer les atlas de la biodiversité ou actualiser les documents d’urbanisme. Le concours de l’AFB sera aussi précieux pour monter des projets éligibles au programme européen Life.
L’établissement public appelé à assurer le « leadership » – selon le terme employé dans l’exposé des motifs du projet de loi – en matière de biodiversité fusionne quatre organismes : l’Agence des aires marines protégées, l’établissement public Parcs nationaux de France, l’Atelier technique des espaces naturels (ATEN : groupement d’intérêt public) et l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA). Ce dernier, qui fournira 900 des 1 200 agents de l’AFB, en sera la colonne vertébrale. L’établissement public, qui entretient des liens étroits avec les agences de l’eau, rend compte à Bruxelles de la reconquête du bon état écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques, visée par la DCE.
L’AFB sera peut-être éclatée en plusieurs sites, sachant que les Parcs nationaux et l’Aten sont installés à Montpellier, que la biodiversité marine devrait logiquement se traiter non loin du littoral (l’Agence des aires marines protégées est basée à Brest) et que les territoires ultra-marins, qui concentrent 80 % de la biodiversité française, constitueront un pan majeur de cette « maison commune », ainsi que la qualifiait Bernard Chevassus au Louis, co-auteur du rapport de préfiguration de l’Agence de 2013.
Il aurait été naturel que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) intègre l’AFB ; les chasseurs, présents au conseil d’administration, ne l’ont pas souhaité. Au grand dam du Conseil national de la transition énergétique et des associations environnementalistes. « La moitié de la police de la nature se trouvera à l’extérieur de l’Agence ! Sans cet organisme, comment traiter les questions de l’ours et du loup ? »
François Letourneux président de la Fête de la nature (et président d’honneur de l’antenne française de l’Union internationale pour la conservation de la nature UICN) tient dans son discours d’ouverture : « En matière de biodiversité, l’expérience de Natura 2000 nous a appris que l’on a besoin d’alliés, notamment parmi les chasseurs ou encore les éleveurs – qui tirent sur le loup ». Sur les liens avec les collectivités et les associations locales, tout est en friche », dit-il. Il ajoute qu’il faille faire preuve « d’imagination administrative » sur les futurs partenariats, d’autant que les réponses ne sont « pas forcément d’ordre législatif ».
Des partenariats devront en outre être noués entre l’AFB et l’Office national des forêts, le Conservatoire du littoral, le Muséum national d’histoire naturelle.
Pour Geneviève Gaillard, rapporteure du projet de loi, « la démarche ne serait pas totalement aboutie sans l’ONCFS : pour que l’Agence marche solidement sur deux jambes, son champ d’intervention doit couvrir la biodiversité aquatique et terrestre de façon équilibrée ». Là encore, l’inclusion de l’ONCFS (120 millions de budget annuel, 1 700 agents dont les représentants sont favorables au rattachement) aurait eu tout son sens.Le budget prévisionnel de l’AFB est de 221 millions d’euros par an, résultant de l’addition des budgets des quatre organismes fusionnés. « En l’état, l’Agence française pour la biodiversité est sous-dotée pour assumer ses missions », estime Annabelle Jaeger, conseillère régionale (EELV) de Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Paca) et membre de l’équipe de préfiguration de l’AFB.
« Pour que l’Agence puisse rendre tous les services attendus, les moyens devraient être doublés », estime la députée (EELV) Laurence Abeille.
De façon opérationnelle Christophe Aubel (jusqu’alors directeur de l’ONG Humanisme et Biodiversité anciennement Ligue ROC) est nommé directeur de l’AFB et Hubert Reeves Parrain d’honneur de cette nouvelle Agence AFB.