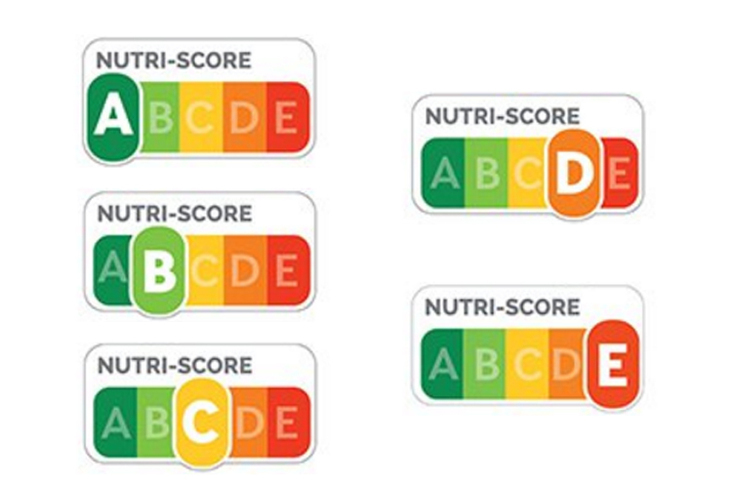Nanoparticules de dioxyde de titane dans l’alimentation (additif E 171) : des effets biologiques qui doivent être confirmés
Le E171 est un additif alimentaire utilisé en tant que colorant et constitué de particules de dioxyde de titane (TiO2), partiellement sous forme nanométrique.Il est présent daet financée dans le cadre du Programme National de Recherche Environnement-Santé-Travail (PNR-EST) piloté par l’Anses dans de nombreux produits de consommations courantes comme dans les cosmétiques, biscuits, bonbons, chewing-gum , et même dans les médicaments. Or une nouvelle étude publiée au mois de janvier 2017 montre que l’exposition chronique de rats au E171 est susceptible de favoriser la formation de lésions colorectales précancéreuses.
L’Anses a été saisie afin d’évaluer si cette publication est de nature à remettre en cause les conclusions de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (Efsa) relatives à l’évaluation du E171, publiées en septembre 2016. Dans ses conclusions, l’Agence souligne que si les résultats présentés dans cette publication ne permettent pas à ce jour de remettre en cause l’évaluation de l’Efsa, elle met en évidence des effets qui n’avaient pas été identifiés auparavant, notamment des effets promoteurs potentiels de la cancérogenèse. Par conséquent, l’Agence souligne la nécessité de conduire, selon des modalités et un calendrier à définir, les études nécessaires à la parfaite caractérisation des effets sanitaires potentiels liés à l’ingestion de l’additif alimentaire E171.
C’est en Janvier 2017 que des chercheurs d’une étude de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra),financée dans le cadre du Programme National de Recherche Environnement-Santé-Travail (PNR-EST) piloté par l’Anses ont publié le 20 janvier 2017 .Ils concluent que l’exposition chronique de rats au dioxyde de titane (additif E171) par voie orale, est susceptible de favoriser la formation de lésions colorectales précancéreuses. Les résultats de l’étude ne permettent toutefois pas de conclure sur les effets du TiO2 sur l’Homme.
Au vu de ces derniers résultats, les ministères chargés de la consommation, de la santé et de l’alimentation ont saisi l’Agence d’une demande d’avis relatif à l’exposition alimentaire aux nanoparticules de dioxyde de titane. L’Agence est également sollicitée pour proposer, si nécessaire, des recommandations sur les voies de travail prioritaires concernant la caractérisation et la toxicité du E171.Cette nouvelle saisine s’inscrit dans les travaux de l’Agence déjà engagés en octobre 2016, sur l’impact potentiel pour la santé des nanomatériaux présents dans l’alimentation.Par ailleurs, l’Anses rappelle l’existence d’autres études, financées par l’appel à projets PNR-EST piloté par l’Agence, en cours de publication et décrivant d’autres effets potentiels du TiO2. Ces études portent notamment sur le passage de la barrière hémato-encéphalique du TiO2. L’ensemble de ces résultats devra faire l’objet d’un examen par l’Efsa dans le cadre de son travail d’évaluation des additifs alimentaires.
Les conclusions et recommandations de l’Agence
Si les résultats de cette publication de l’Inra ne permettent pas à eux seuls de remettre en cause l’évaluation du E171 menée par l’Efsa, l’Anses souligne la nécessité de conduire, selon des modalités et un calendrier à définir, différentes études nécessaires à la parfaite caractérisation du danger associé au E171. Cette étude met en évidence des effets qui n’avaient pas été identifiés auparavant, notamment les potentiels effets promoteurs de la cancérogenèse du E171. Ces effets potentiels du E171, observés au niveau du côlon, nécessitent donc d’être confirmés par des expérimentations complémentaires.
Nanomatériaux et risques associés : les recommandations de l’Agence
Cette nouvelle saisine fait suite à de très nombreux travaux portés par l’Agence au cours des dernières années sur la thématique des nanomatériaux et des risques associés. Ainsi, dans son avis du 15 avril 2014 relatif à l’évaluation des risques liés aux nanomatériaux, l’Anses pointait la disponibilité d’éléments toxicologiques suffisants pour envisager la classification de différents nanomatériaux, au titre du règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges dit CLP, dont le dioxyde de titane.
Par ailleurs, l’apparition de tumeurs pulmonaires chez le rat après inhalation ou instillation de TiO2 a amené l’Anses, le 20 mai 2015, à soumettre à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) une proposition de classement du dioxyde de titane en tant que substance cancérogène de catégorie 1B (substance dont le potentiel cancérogène pour l’être humain est supposé) par inhalation, dans le cadre du règlement CLP. Une décision de l’ECHA est attendue pour le second semestre 2017.
Concernant les nanomatériaux, de nombreux travaux sont menés par l’Anses depuis 2006, tant sur l’alimentation humaine et animale que sur les produits de consommation ou l’exposition des travailleurs. L’Agence rappelle la nécessité de développer des protocoles d’étude de toxicologie pertinents (bonne caractérisation physico-chimique, protocole détaillé et reproductible, etc.) et des études d’exposition pour évaluer les risques sanitaires des produits contenant des nanomatériaux.
L’Anses recommande également de limiter l’exposition des salariés, des consommateurs et de l’environnement, notamment en favorisant les produits sûrs, dépourvus de nanomatériaux, et équivalents en termes de fonction, d’efficacité et de coût. Dès lors que des dangers sont identifiés pour la santé humaine ou pour l’environnement, l’Agence recommande de peser l’utilité, pour le consommateur ou la collectivité, de la mise sur le marché de tels produits contenant des nanomatériaux, pour lesquels les bénéfices devraient être clairement démontrés.
Enfin, l’Agence recommande de renforcer la traçabilité des produits de consommation contenant des nanomatériaux, essentielle aux travaux d’évaluation des risques, notamment par l’amélioration du processus de déclaration mis en œuvre dans le cadre du portail national R-nano, afin d’assurer une meilleure description des nanomatériaux mis sur le marché, de leurs usages précis et des expositions de la population associées.