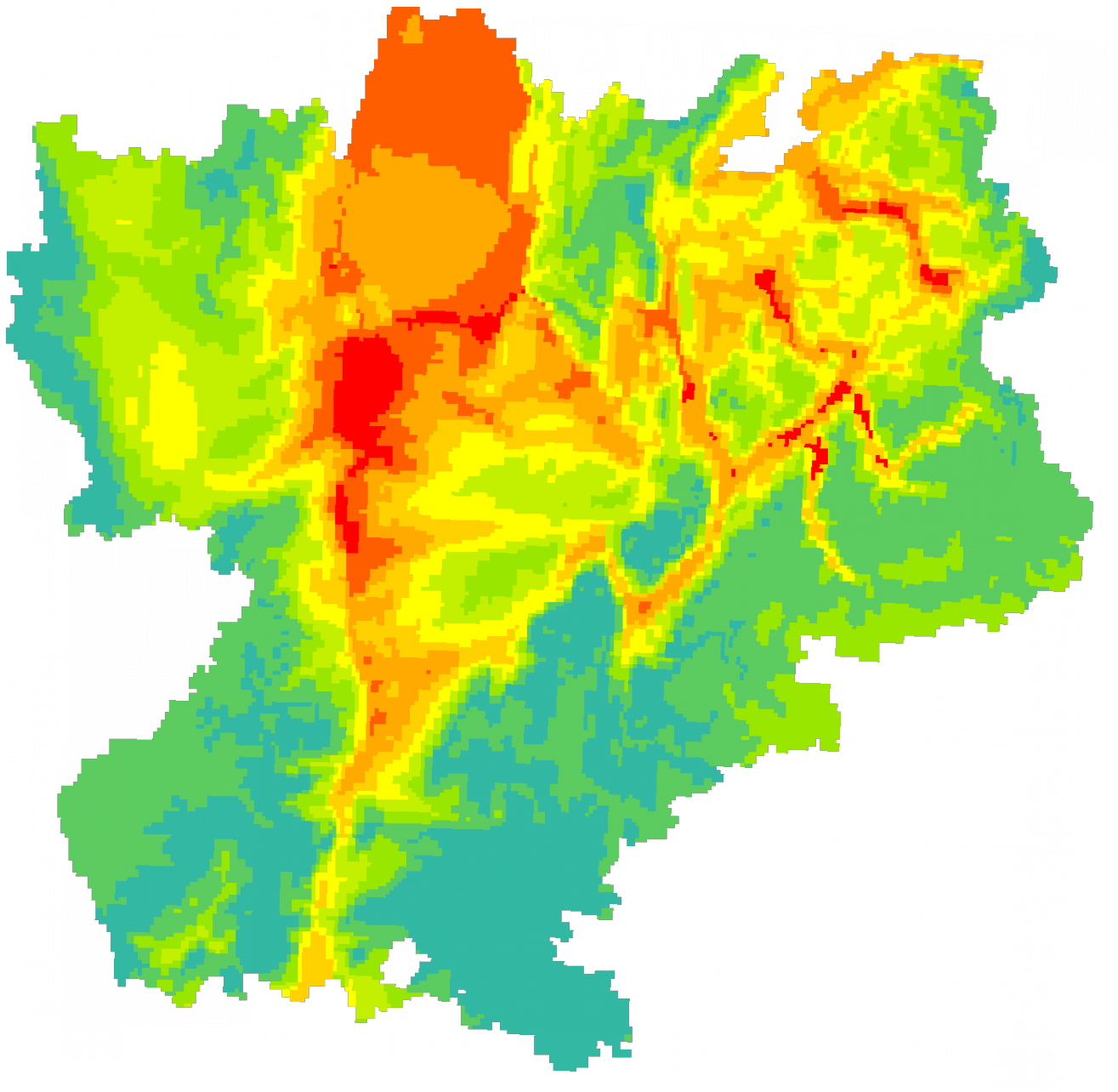L’Agence nationale des fréquences a publié pour la première fois les résultats de ses tests sur l’émission d’ondes électromagnétiques des téléphones portables. Voici ses conclusions sur près de 400 appareils analysés.
L’Agence nationale des fréquences a publié pour la première fois les résultats de ses tests sur l’émission d’ondes électromagnétiques des téléphones portables. Voici ses conclusions sur près de 400 appareils analysés.
Les téléphones portables respectent bien la réglementation européenne en termes d’émission d’ondes électromagnétiques : c’est la conclusion principale des tests menés par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) sur 379 téléphones portables et rendus publics en juin 2017 (la liste des portables analysés est à consulter via ce lien). La publication de ces mesures marque un revirement de position de la part de l’ANFR qui avait indiqué début janvier 2017 ne pas pouvoir ouvrir leur accès au grand public, malgré un avis favorable de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada). Commission qui avait été saisie par un citoyen, Marc Arazi, ex-coordinateur de l’association de défense de l’environnement Priartem. Désormais, l’Agence s’engage à publier chaque trimestre ses mesures réalisées sur les appareils commercialisés sur le marché français.
Mesuré en watt par kilogramme (W/kg), le DAS correspond à la partie de l’énergie électromagnétique que le portable dégage et qui est absorbée par notre corps. Équipés de mannequins remplis d’un liquide dont les caractéristiques d’absorption sont identiques à celles du corps humain, les laboratoires ont mené deux types de mesures : lorsque le portable est au contact de l’oreille et lorsqu’il est positionné près du tronc (par exemple dans la poche d’une veste ou dans un sac, mimant les conditions d’un appel en kit mains-libres). « Tous les DAS sont conformes à la réglementation en vigueur, soit inférieurs à 2 W/kg », résume l’ANFR. Au niveau de l’oreille, les valeurs maximales mesurées varient selon les appareils entre 1 W/kg et 1,8 W/kg, et au niveau du tronc, elles oscillent entre 1,1 W/kg et 1,4 W/kg.