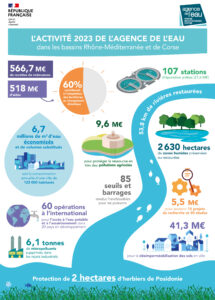L’Arcep (Autorité de Régulation des Communications Électroniques, des Postes et de la Distribution de la Presse)a publiée le jeudi 21 mars son enquête annuelle « Pour un numérique soutenable« . Ce rapport nous donne quelques précisions éclairantes sur l’activité du numérique en France.
- La consommation d’énergie des opérateurs provient des réseaux fixes et mobiles, de leurs centres de données, ou encore de leurs flottes de véhicules, locaux commerciaux, et bâtiments administratifs.La consommation énergétique des réseaux fixes et mobiles, en croissance depuis 2017, augmente de 7 % en 2022. À l’inverse, la consommation énergétique des réseaux fixes diminue du fait du remplacement progressif du cuivre par la fibre optique, plus efficace énergétiquement.
Alors qu’en 2022 les émissions de GES en France ont diminué de 2,7 % par rapport à 2021 (1), les émissions de GES des principaux opérateurs télécoms ont augmenté de 2 % en un an, passant de 373 000 à 382 000 tonnes équivalent CO2.Des émissions de gaz à effet de serre en croissance de 14 % en un an, portées par la progression de la consommation électrique.De même, les box et les décodeurs consomment au total 3,3 TWh, soit 0,7 % de la consommation d’électricité totale en France. Cette augmentation n’est pas due à l’utilisation qui en est faite, mais plutôt au type de modèle.
2. Pour les centres de données
3. Les principaux enseignements
- Des trois composantes du numérique qui constituent le périmètre de l’étude, ce sont les terminaux (et en particulier les écrans et téléviseurs) qui sont à l’origine de 65 à 90 % de l’impact environnemental, selon l’indicateur environnemental considéré.
- Parmi tous les impacts environnementaux, l’épuisement des ressources énergétiques fossiles, l’empreinte carbone, les radiations ionisantes, liés à la consommation énergétique, ainsi que l’épuisement des ressources abiotiques (minéraux et métaux) ressortent comme des impacts prédominants du numérique.
- La consommation électrique pour les services numériques en France est estimée à 48,7 TWh, ce qui peut être comparé à la consommation totale de 475 TWh [1], signifiant que les services numériques sont responsables de 10% de la consommation électrique française, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 8 282 000 foyers français.
- L’empreinte carbone des services numériques en France est égale à 16,9 Mt CO2 eq., ce qui peut être comparé au 663 MT CO2 eq. total [2], signifiant que les services numériques sont responsables de 2,5% de l’empreinte carbone de la France – légèrement supérieurs à l’équivalent du secteur des déchets en France (2%).
- 62,5 millions de tonnes de ressources (MIPS [3]) sont utilisées par an pour produire et utiliser les équipements numériques.
- 20 millions de tonnes de déchets produits par an sur l’ensemble du cycle de vie
À l’échelle d’un citoyen :
- Les impacts moyens annuels de l’utilisation du numérique sur le changement climatique sont similaires à 2 259 km en voiture / habitant.
- La production de déchets est égale à 299 kg / habitant sur l’ensemble du cycle de vie des équipements (de leur fabrication à leur fin de vie).
- La masse de matériaux déplacée durant la phase de fabrication est égale à 932 kg / habitant.
-
Les premiers responsables des impacts du numérique sont les terminaux « utilisateur », c’est-à-dire les appareils électroniques (entre 64% et 92% des impacts, en premier lieu les écrans de télévision), suivi par les centres de données (entre 4% et 22% des impacts) et les réseaux (entre 2% et 14 %).