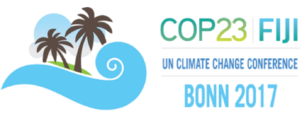 Le Monde » publie le manifeste signé par 15 364 scientifiques de 184 pays dans la revue BioScience. L’ampleur de l’initiative est sans précédent. Plus de 15 000 scientifiques de 184 pays signent un appel contre la dégradation catastrophique de l’environnement.
Le Monde » publie le manifeste signé par 15 364 scientifiques de 184 pays dans la revue BioScience. L’ampleur de l’initiative est sans précédent. Plus de 15 000 scientifiques de 184 pays signent un appel contre la dégradation catastrophique de l’environnement.
« Mise en garde des scientifiques à l’humanité : deuxième avertissement. » C’est une alerte solennelle que publient, lundi 13 novembre , plus de 15 000 scientifiques de 184 pays. Biologistes, physiciens, astronomes, chimistes ou encore agronomes, spécialistes du climat ou des océans, de zoologie ou d’halieutique, les auteurs mettent en garde contre la destruction rapide du monde naturel et le danger de voir l’humanité pousser « les écosystèmes au-delà de leurs capacités à entretenir le tissu de la vie ».
Leur texte, que publie Le Monde en intégralité, enjoint aux décideurs et aux responsables politiques de tout mettre en œuvre pour « freiner la destruction de l’environnement » et éviter que ne s’aggrave l’épuisement des services rendus par la nature à l’humanité. « Pour éviter une misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité, l’humanité doit adopter une alternative plus durable écologiquement que la pratique qui est la sienne aujourd’hui. »
L’ampleur du soutien à cette mise en garde reflète une inquiétude qui traverse toutes les disciplines des sciences expérimentales. L’appel des 15 000 est, à ce jour, le texte publié par une revue scientifique ayant rassemblé le plus grand nombre de signataires.
C’est la deuxième fois que les « scientifiques du monde » adressent une telle mise en garde à l’humanité. Le premier appel du genre, publié en 1992 à l’issue du Sommet de la Terre à Rio (Brésil), avait été endossé par quelque 1 700 chercheurs, dont près d’une centaine de Prix Nobel. Il dressait déjà un état des lieux inquiétant de la situation et s’ouvrait sur cette alerte : « Les êtres humains et le monde naturel sont sur une trajectoire de collision. » Ce premier appel n’a pas été suivi d’effets. Un quart de siècle plus tard, la trajectoire n’a pas changé.
Voici – sans ordre d’urgence ni d’importance – quelques exemples de mesures efficaces et diversifiées que l’humanité pourrait prendre pour opérer sa transition vers la durabilité :
- privilégier la mise en place de réserves connectées entre elles, correctement financées et correctement gérées, destinées à protéger une proportion significative des divers habitats terrestres, aériens et aquatiques – eau de mer et eau douce ;
- préserver les services rendus par la nature au travers des écosystèmes en stoppant la conversion des forêts, prairies et autres habitats originels ;
- restaurer sur une grande échelle les communautés de plantes endémiques, et notamment les paysages de forêt ;
- ré-ensauvager des régions abritant des espèces endémiques, en particulier des superprédateurs, afin de rétablir les dynamiques et processus écologiques ;
- développer et adopter des instruments politiques adéquats pour lutter contre la défaunation, le braconnage, l’exploitation et le trafic des espèces menacées ;
- réduire le gaspillage alimentaire par l’éducation et l’amélioration des infrastructures ;
- promouvoir une réorientation du régime alimentaire vers une nourriture d’origine essentiellement végétale ;
- réduire encore le taux de fécondité en faisant en sorte qu’hommes et femmes aient accès à l’éducation et à des services de planning familial, particulièrement dans les régions où ces services manquent encore ;
- multiplier les sorties en extérieur pour les enfants afin de développer leur sensibilité à la nature, et d’une manière générale améliorer l’appréciation de la nature dans toute la société ;
- désinvestir dans certains secteurs et cesser certains achats afin d’encourager un changement environnemental positif ;
- concevoir et promouvoir de nouvelles technologies vertes et se tourner massivement vers les sources d’énergie vertes tout en réduisant progressivement les aides aux productions d’énergie utilisant des combustibles fossiles ;
- revoir notre économie afin de réduire les inégalités de richesse et faire en sorte que les prix, les taxes et les dispositifs incitatifs prennent en compte le coût réel de nos schémas de consommation pour notre environnement ;
- déterminer à long terme une taille de population humaine soutenable et scientifiquement défendable tout en s’assurant le soutien des pays et des responsables mondiaux pour atteindre cet objectif vital.
Pour éviter une misère généralisée et une perte catastrophique de biodiversité, l’humanité doit adopter une alternative plus durable écologiquement que la pratique qui est la sienne aujourd’hui. Bien que cette recommandation ait été déjà clairement formulée il y a vingt-cinq ans par les plus grands scientifiques du monde, nous n’avons, dans la plupart des domaines, pas entendu leur mise en garde. Il sera bientôt trop tard pour dévier de notre trajectoire vouée à l’échec, car le temps presse. Nous devons prendre conscience, aussi bien dans nos vies quotidiennes que dans nos institutions gouvernementales, que la Terre, avec toute la vie qu’elle recèle, est notre seul foyer.