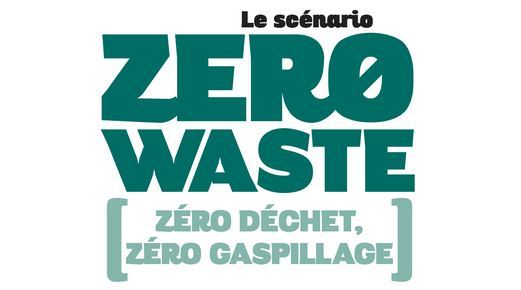Alors que notre pays connaît depuis des semaines, des inondations au delà du commun, la taxe inondations dite taxe GEMAPI montre bien sa pertinence.
Jusque là , l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages de protection contre les crues incombaient à tous les niveaux de collectivités. Les régions, les départements, les communes et leurs intercommunalités pouvaient s’en saisir, mais aucune de ces collectivités ne se sentaient spécifiquement responsable. C’est pourquoi compte tenu de la fréquence des ces inondations à travers la France dans un contexte de changements climatiques qu’il paraissait nécessaire de clarifier la situation.
Issue de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique cette nouvelle compétence a été crée pour une meilleure gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, pour l’attribuer aux communes et à leurs groupements.
Désormais et ce, à compter du 1er janvier ces travaux d’entretien seront exclusivement confiés aux communes et à leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP). En effet, la loi attribue aux communes à compter du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence sur la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Elle a été transférée de droit aux EPCI FP : communautés de communes, communautés d’agglomération, communauté urbaines et métropoles.
Les communes et leurs EPCI FP ont par ailleurs la possibilité de créer sur leur territoire une taxe facultative, plafonnée à 40 €/habitant et affectée exclusivement à l’exercice de cette compétence.Grâce à une disposition introduite dans la loi de finances rectificative pour 2017 vote du PLFR 2017, les EPCI compétents en matière de Gemapi ont jusqu’au 15 février 2018 pour voter les délibérations relatives à l’institution et au montant de la taxe du même nom.  L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la DREAL de bassin Rhône-Méditerranée ont comme objectif de redonner à nos rivières un fonctionnement naturel pour limiter les crues, sécuriser les populations et améliorer la qualité de l’eau, en laissant plus d’espace à la rivière, afin d’en freiner le débit de l’eau et mieux gérer l’eau à l’échelle du bassin versant. .
L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la DREAL de bassin Rhône-Méditerranée ont comme objectif de redonner à nos rivières un fonctionnement naturel pour limiter les crues, sécuriser les populations et améliorer la qualité de l’eau, en laissant plus d’espace à la rivière, afin d’en freiner le débit de l’eau et mieux gérer l’eau à l’échelle du bassin versant. .
Pour plus de détails : Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse • 2-4 allée de Lodz • 69363 Lyon Cedex 07 tél : 04 72 71 26 00 • fax : 04 72 71 26 01
www.eaurmc.fr/fileadmin/grands-dossiers/documents