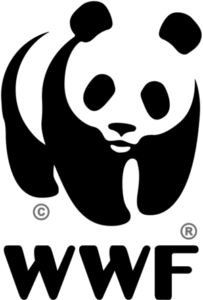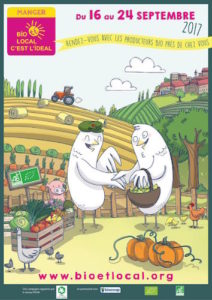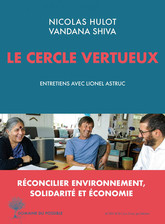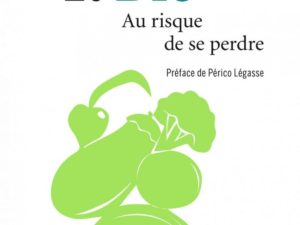Une étude danoise publiée dans l’International Journal of Cancer. nous met en évidence une nouvelle fois les risques potentiels de la présence des nitrates dans les eaux de consommation, alors que depuis longtemps des études démontaient les effets délétères en particulier pour les enfants et les femmes allaitantes. Cette étude fait le lien avec le cancer colorectal.
La concentration « naturelle » en nitrates des eaux souterraines en l’absence de fertilisation va de 5 à 15 mg/l (NO3). Mais la source majeure provient de l’apport d’engrais azotés. Cet apport peut se faire soit directement sous forme de nitrates, soit sous forme d’ammoniac, ou d’urée, lesquels se transforment dans le sol en nitrates. Certains engrais associent les deux formes, comme le nitrate d’ammonium, qui dans les sols libère immédiatement des nitrates, avant de générer plus lentement des nitrates issus de l’oxydation de l’ammoniac. Les lisiers d’élevage libèrent surtout la forme ammoniaquée. Les nitrates dans les eaux continentales proviennent à 66 % de l’agriculture (engrais azotés et lisier). Le reste est issu des rejets des collectivités locales (22%) et de l’industrie (12%).
Rappelons que la norme de 50mg/l est celle qui est retenue depuis des années en France. Le décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 fixe cette limite à 50 milligrammes par litre en nitrates de l’eau destinée à la consommation humaine. La norme de 50 mg/L a été fixée en fonction des risques courus par les populations les plus vulnérables Les nitrates dans l’eau sont souvent issus de l’emploi de fertilisants agricoles,ceux ci ont la fâcheuse manie de se transformer en composés N-nitroso, fortement cancérigènes –de la même manière que les nitrites, utilisés par l’industrie alimentaire en particulier…
L’ion nitrate est la forme stable de l’azote, formé par l’association d’un atome d’azote avec trois atomes d’oxygène. Une fois ingéré, il peut être réduit en nitrite par les bactéries présentes dans le corps, en particulier dans la bouche, mais aussi l’intestin grêle et le côlon. A partir de 25 mg/L, les nouveaux-nés peuvent manquer d’oxygène parce que les nitrites issus des nitrates oxydent le fer ferreux (Fe2+) de l’hémoglobine des globules rouges en fer ferrique (Fe3+). La méthémoglobine qui en résulte est incapable de fixer l’oxygène. Dans un milieu acide, l’estomac par exemple, l’ion nitrite donne naissance à de l’acide nitreux qui génère du dioxyde d’azote. Le dioxyde d’azote est capable de réagir avec des susbtances azotées qu’on appelle amines pour former des individus très peu fréquentables, les nitrosamines. Les nitrosamines endommagent les gènes et provoquent des cancers dans toutes les espèces animales. Les nitrites représentent un risque pour la santé du nourrisson de moins de 6 mois en raison de l’immaturité de l’activité de la « méthémoglobine réductase ». Les adultes porteurs d’un déficit enzymatique (en G6PDH ou en MetHb-réductase) sont également exposés.
Listes des zones vulnérables aux nitrates au 21 février 2017 en auvergne Rhône-Alpes
http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/Revision-du-zonage-dit-zones
Ward MH : Workgroup Report: Drinking-Water Nitrate and Health—Recent Findings and Research Needs. Environ Health Perspect. 2005, 113(11): 1607–1614.
http://onlinelibrary.wiley.com