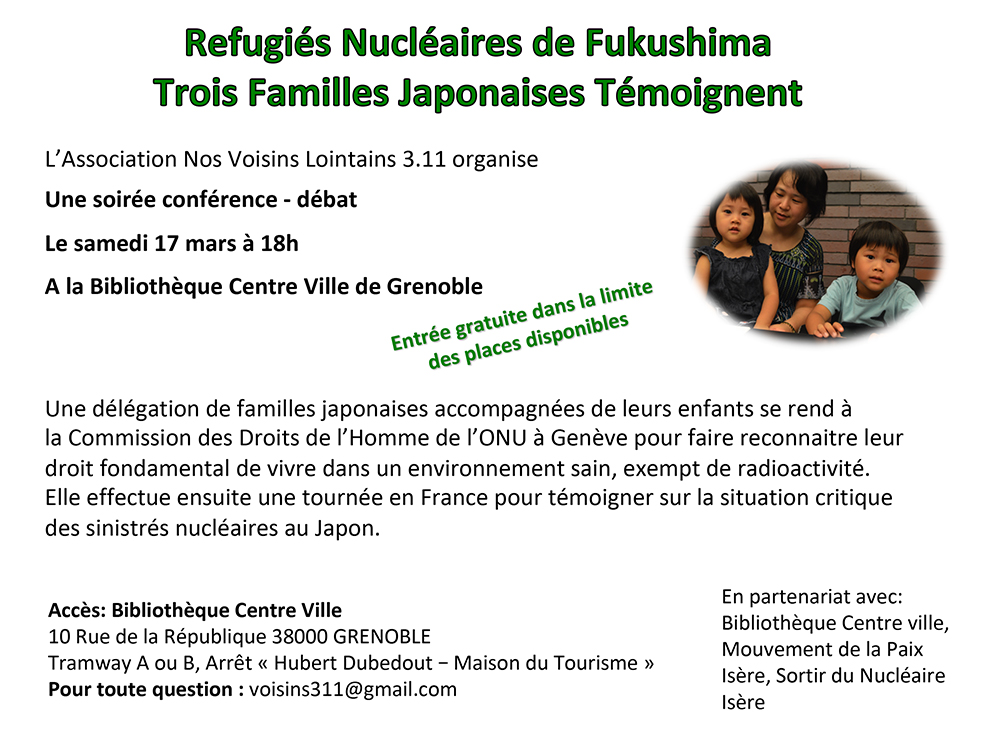Évoquée à plusieurs reprises par le Premier ministre indien, l’alliance internationale pour le solaire (ASI) est devenue une réalité. Elle avait été instaurée le 30 novembre 2015 à la COP 21. Son objectif : exploiter le potentiel photovoltaïque des pays du Sud.
Vieux rêve du Premier ministre indien Narendera Modi, cette initiative vise à exploiter l’important gisement solaire des pays tropicaux. « Nous ne pouvons plus accepter que les pays les plus ensoleillés concentrent une si faible production photovoltaïque », avait insisté le président Hollande. L’Alliance solaire, lancée à Paris lors de la COP 21 en 2015, compte suffisamment de membres et de ratifications pour pouvoir fonctionner. Son siège sera installé en Inde, avec le soutien de la France. La Cop 23 à B onn a relancé ce projet international en décembre 2017 elle est devenue une entité juridique internationale à part entière,et a été ratifiée par 16 pays, est donc entrée en vigueur le 7 décembre 2017. Son objectif est de créer un guichet unique et lisible pour les investisseurs afin d’orienter les flux financiers vers le terrain.
Pourquoi l’Inde? En effet ce pays propose aux « pays riches en solaire » de développer des réseaux et des synergies entre eux. L’objectif est de soutenir l’innovation dans les domaines connectés au réseau, mais pas seulement. Dans ces régions où de nombreux habitants n’ont pas encore accès à l’électricité, l’alliance doit permettre de faire émerger des applications déconnectées et décentralisées : électrification de villages et mini-réseaux, lanternes solaires, chargeurs de téléphones, pompes… Des développements dans des secteurs aussi variés que la chaleur, le froid, le dessalement, la désinfection, la stérilisation, le pompage, le stockage, les télécommunications sont aussi envisagés…
La venue du président français à New Delhi a été l’occasion de poser la première pierre de ce projet ce 11 mars, en présence du Premier ministre indien Narendra Modi et d’Emmanuel Macron. L’alliance a ainsi été inaugurée à New Delhi, elle rassemble désormais 52 pays et vise à réunir 1.000 milliards de dollars d’ici à 2030 pour réaliser 1.000 gigawatts de capacité photovoltaïque.Sont concernés les pays »riches » en soleil, situés dans la zone intertropicale, qui ont un grand besoin de mini-centrales photovoltaïques pour amener l’électricité dans les villages et de pompes à eau fonctionnant au solaire. La création de l’ASI est censée sécuriser les investissements en direction de ces 121 Etats situés entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Ceux-ci ne représentent que 23% des capacités photovoltaïques mondiales alors qu’ils bénéficient de plus de 300 jours d’ensoleillement annuel.
Les projections des capacités installées pour 2021 placent la Chine en tête des pays équipés d’énergie solaire, devant les Etats-Unis. L’Inde arrive en troisième position et accélère ses objectifs en matière d’énergies renouvelables. Son gouvernement a porté à 100 gigawatts (GW) la capacité solaire installée d’ici 2022. Sa production d’énergies renouvelables (hors gros hydraulique) atteint d’ores et déjà 60 gigawatts, soit 18% de la production nationale d’énergie, dont 20 GW issus du solaire. La Banque européenne d’investissement a annoncé le 10 mars un prêt aux installations d’énergies renouvelables en Inde d’un montant de 800 millions d’euros.