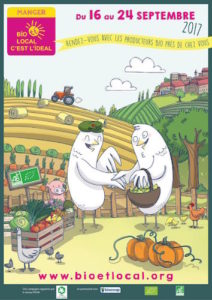Les députés ont voté en commission des amendements de l’ancienne ministre de l’écologie Delphine Batho (PS) pour notamment inscrire ces 50 % dans le projet de loi agriculture et alimentation.«Le président de la République avait pris l’engagement devant les citoyens durant sa campagne électorale de 50 % de produits bio, écologiques, ou issus de circuits courts dans les cantines scolaires et les restaurants d’entreprise», a justifié la députée des Deux-Sèvres.
Un objectif pour améliorer la qualité des produits proposés qu’a déjà atteint la ville de Grenoble, avec pour ambition atteindre le 100%.
Les repas servis dans les cantines devront comprendre au moins 50 % de produits acquis selon des modalités prenant en compte le coût du cycle de vie du produit, de produits issus de l’agriculture biologique, de ceux bénéficiant de l’écolabel pêche, et encore ceux issus d’une exploitation ayant fait l’objet d’une certification environnementale. La part fixée pour le bio est d’au moins 20 % de la valeur totale.
Un autre amendement intéressant : celui du rapporteur Jean-Baptiste Moreau (LREM), qui proposent aux collectivités territoriales qu’elles pourraient interdire les contenants alimentaires de cuisson en matière plastique, de réchauffe et de service , dans les services de restauration collective dont elles ont la charge. Ces expérimentations permettront notamment d’évaluer l’impact de la mesure sur la santé.
Également adopté, un amendement porté par Laurence Maillart-Méhaignerie (LREM) qui prévoit que les organismes de restauration collective publique servant plus de 100 couverts par jour en moyenne sur l’année seront tenus de présenter un plan pluriannuel de diversification de protéines.