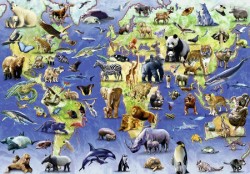Notre corps et en particulier notre système digestif, est colonisé par des millions de bactéries vivant en symbiose avec notre organisme. Sans elles, certaines substances ne pourraient pas être digérées et nous serions trop vulnérables à leurs congénères pathogènes.
Le déséquilibre du microbiote, en termes de diversité d’espèces bactériennes ou de quantité de bactéries, est aussi appelée dysbiose. On la retrouve dans de nombreuses pathologies, comme l’obésité, le cancer ou même l’autisme. Les scientifiques pensaient jusqu’à maintenant que les anticorps de type IgA que nous sécrétons massivement dans notre tube digestif (66 mg/kg/jour) empêchaient le passage de germes potentiellement dangereux à travers la barrière intestinale mais ses effets potentiels sur le microbiote restaient flous. Des anticorps auraient pour rôle de barrer le passage ou d’encourager l’installation de bactéries pour obtenir le meilleur équilibre possible au sein de notre microbiote intestinal. Appelés IgA, ces anticorps sont de véritables « chefs d’orchestre » du microbiote, d’après une nouvelle étude.
La fonction et la santé de notre microbiote intestinal est en partie régulé par nos anticorps, ont conclu des chercheurs de l’équipe du centre de recherche CIMI (Inserm / Sorbonne Université) et du département d’Immunologie de l’hôpital Pitié-Salpêtrière (AP-HP) dans une publication parue dans la revue Science Translational Medicine. Ces anticorps, d’un type particulier appelé IgA, seraient de véritables chefs d’orchestre du microbiote, empêchant l’installation de certaines bactéries et en favorisant d’autres.