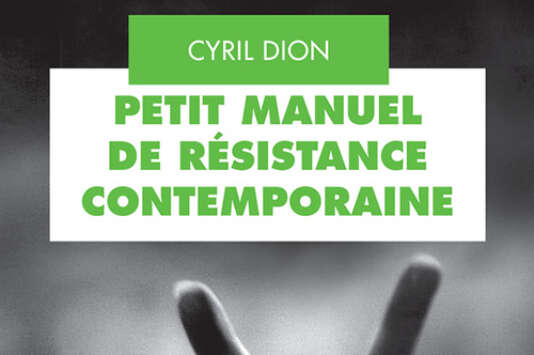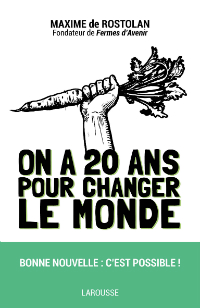Notre alimentation de plus en plus industrielle comporte de plus en plus d’additifs de synthèse afin d’améliorer la coloration( édulcorants), l’aspect, et de prolonger leur durée d’utilisation ( stabilisants,conservateurs).
Parmi eux, les célèbres glutamate de sodium (E621) et l’aspartame (E 951). Le glutamate est utilisé pour relever le goût de la plupart des aliments salés et l’aspartame pour donner du goût sucré sans les calories. Or les études relatives à leur utilisation dans le domaine alimentaire sont souvent cachées sous silence au seul prétexte qu’ils sont en quantité infime et que les effets cocktails de ces produits ne sont quasiment pas possibles tant ils peuvent se présenter en combinaisons multiples.
Revenons au glutamate monosodique GMS (E621) qui est un acide aminé naturellement présent dans l’organisme utilisé surtout par le système nerveux. Il joue un rôle dans la synthèse des protéines, la protection immunitaire, le maintient de l’intégrité de la paroi intestinale et l’équilibre acido- basique de l’organisme. Il participe aussi aux phénomènes d’apprentissage et de mémorisation. Il n’est pas un acide aminé essentiel car le corps peut le synthétiser à partir de plusieurs protéines animales et végétales. L’acide glutamique naturel ne présente aucun danger pour l’organisme, mais lorsque il est synthétisé chimiquement les effets sont bien différents:en renforçant le goût des ingrédients, il agit comme un excitant sur les papilles gustatives et surtout, sur le cerveau..Du glutamate, on en trouve partout : dans les chips, la mayonnaise, les ketchups, les plats cuisinés transformés, les gâteaux apéritifs, la charcuterie…,et plus particulièrement dans les bouillons.
Une consommation élevée de glutamate, peut contribuer à avoir un taux dans le sang de 20 à 60 fois supérieure à la normale et ainsi constituer une menace pour les organes. Sa dose journalière est fixée en 2017 à 30 mg par kg de masse corporelle par jour par l’EFSA (Autorité Européenne de sécurité des Aliments).
Le glutamate mono sodique se cache sous d’autres noms : GMS, E 621, extrait de levure, gélatine, protéines végétales hydrogénées, huile végétale hydrogénées, huile de maïs, arômes naturels ou artificiels, extraits de malt, arômes de malt, protéines de blé, maltodextrine, caséinate de sodium ou de calcium,…C’est le professeur japonais Kikunae Ikéda qui en a fait la synthése chimique le premier . Et c’est ainsi que, depuis 1910 les industriels en font usage courant comme un exhausteur de goût,car il a la faculté de compenser les déperditions de goût des aliments transformés.en présentant un avantage économique considérable pour l’industrie, en permettant de réduire la quantité de matières premières. Cependant dés 1970, la FDA interdit le GMS dans les aliments pour bébés.
Pour l’aspartame terme technique pour les marques NutaSweet, Canderel, Equal, Equal-Measure, Spoonful. Il est composé de 50% de phénylalanine, de 40% d’acide aspartique et de 10% de méthanol. Son code est E 951. C’est est un édulcorant artificiel très répandu avec un pouvoir sucrant 200 fois supérieur à celui du saccharose. La dose journalière admissible de l’aspartame est fixée aux USA par la FDA à 50 mg par jour et par kilogramme de masse corporelle, alors que dans l’Union Européenne, elle est fixée par l’EFSA à 40 mg ;
Conçu pour se substituer au sucre c’est-à-dire en donnant un goût sucré sans les calories, l’aspartame induit en erreur le pancréas qui fait libérer une forte dose d’insuline en réponse au message sucré alors qu’il n’en est rien. De l’aspartame, on en trouve là où on ne l’attend pas : chewing-gums, sodas, jus de fruits, boissons gazeuses, les suppléments en vitamines et en minéraux, sucrettes, boissons «light », boissons instantanées, dessert, yaourts, vinaigrette, médicaments, sirop pour enfants, etc. Quant sur l’étiquette, c’est marqué « diet », « 0% », « sans sucre », « light », « allégé », vous êtes nez-à nez avec un édulcorant et trés souvent celui là.Certaines études montrent que les personnes consommant de l’aspartame ont toujours envie de manger plus encore, favorisant une prise de poids que les personnes n’en mangeant pas. Ce qui est confirmé par une étude de l’American Cancer Society sur 80 000 femmes suivies pendant 6 ans.
Un rapport de la FDA répertorie 92 effets secondaires documentés de l’ingestion d’aspartame parmi lesquels on peut citer la perte de mémoire, la dépression, le gain de poids, maux de tète, insomnie, dysfonctionnement sexuel, asthme, arthrite, difficultés respiratoires, douleurs thoraciques toux chronique, soif ou faim excessif, impuissance sexuelle, crampes, acouphène, vision floue, cécité, convulsion, perte de la vision, diabète, fibromyalgie, cancers, urticaires, anomalies congénitales, retard mental, maladie de Parkinson et d’Alzheimer, etc.
Il a été découvert par sérendipité en 1965 par James Schlatter, un chimiste de G.D Searle Company en testant un médicament anti ulcéreux. La FDA (Food and Drug Administration), chargée d’étudier les demandes d’autorisation concernant les nouvelles substances a, pendant 16 ans refusé l’utilisation de cet édulcorant dans l’alimentation humaine pour cause de toxicité.
C’est pourquoi nous ne cesserons de prôner une alimentation saine qui est celle qui provient de la terre la moins complémentée en intrants chimiques, ou de la mer dans les lieux éloignés des zones polluées, bio et sans aucun process. A défaut, ayez l’habitude, en faisant vos courses de lire les étiquettes, et surtout, se rappeler que la liste des ingrédients l’est par ordre décroissant et de ce fait éviter ainsi les additifs douteux. Plus la liste est courte, mieux c’est !
Réference : le docteur Russel Blaylock, neurochirurgien américain a rassemblé près de cinq cent références scientifiques pour montrer comment un excès d’acides aminés libres excitateurs est responsable de désordres pouvant provoquer des maladies chroniques. Selon ses conclusions l’aspartame provoque le cancer et la tumeur cancéreuse se nourrit de glutamate mono sodique.
En complément «Le glutamate mono sodique comme exhausteur de goût», Annais Deppenwaller ( Ed. Paf -2014),