A l’occasion de cette journée l’accent est mis contre ce phénomène inquiétant par un rapport de l’ONU faisant état que 2 milliards d’hectares de terres sont aujourd’hui dégradés dans le monde, du fait des activités humaines et du réchauffement climatique.
C’est le 17 juin 1992, que l’ONU a adopté la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD). Cette journée a pour but de nous rappeler les dangers de la désertification et de la sécheresse dans le monde. Tout d’abord, il est important de souligner que les déserts ne sont pas uniquement des lieux où l’on trouve des dunes de sables et des nomades les parcourant. Ainsi l’Antarctique ou le grand Nord, sont des espaces désertiques, parce que l’eau y est prise en glace. Deuxièmement, l’homme n’est pas responsable, à l’origine des déserts mais aujourd’hui il y contribue.
Or c’est un processus qui s’accélère et qui touche tous les continents, sans exception. L’Afrique est bien sûr la plus touchée, mais c’est aussi le cas de l’Asie, de l’Amérique latine et même de l’Europe du Sud. Cette situation affecte 3 milliards de personnes – à commencer par leur accès aux ressources alimentaires et à l’eau – elles sont parmi les plus pauvres et les plus vulnérables.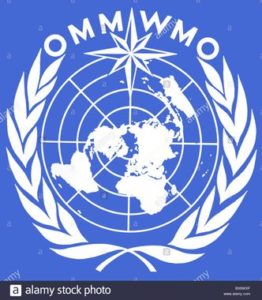 Le secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification, Ibrahim Thiaw appelle à un changement de modèle de production et de consommation. L’enjeu est vital pour l’humanité.
Le secrétaire exécutif de la Convention des Nations unies pour la lutte contre la désertification, Ibrahim Thiaw appelle à un changement de modèle de production et de consommation. L’enjeu est vital pour l’humanité.
Ceci fait écho au le rapport de l’IPBES [Plate-forme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques] publié en Mai qui a alerté sur le fait qu’un million d’espèces faune et flore sont menacées d’extinction.
